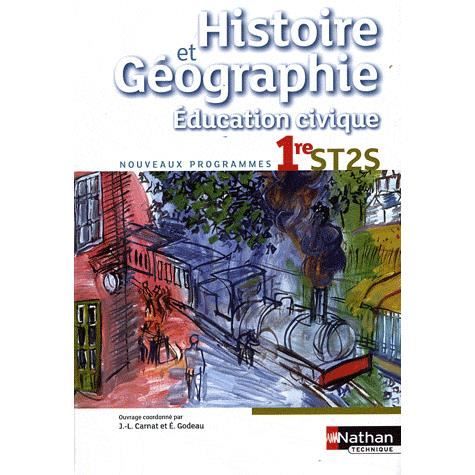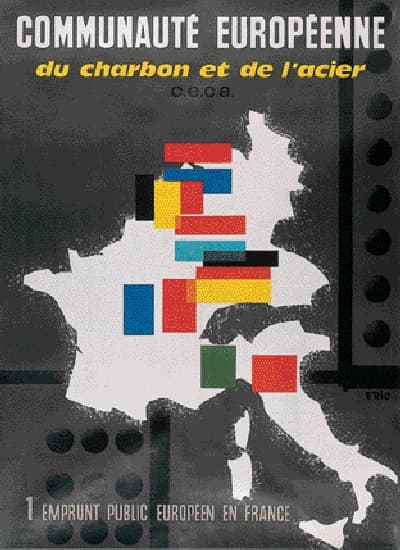« L’Union européenne
dans la mondialisation » est l’une des deux questions à traiter dans le cadre du
thème 4 « France et Europe dans le monde », auquel le programme préconise de
consacrer 11à 12 heures au total. L’intitulé du programme invite à mesurer le
rôle et la place de l’Union européenne dans la mondialisation, ce qui constitue
une des clés de l’avenir de l’Europe.
PROBLEMATIQUES
- En quoi l’Union
européenne est-elle un des centres d’impulsion de la mondialisation ? Quel
est son rôle dans un monde de plus en plus multipolaire ? Quelles sont les
limites à son influence ?
- Qu’est - ce qui fait de la Northern Range
une façade maritime mondiale ? Comment expliquer son importance et sa
localisation ? Quels aménagements sont nécessaires pour qu’elle maintienne sa
place dans le concert des pôles maritimes majeurs ?
- En quoi la Méditerranée est-elle un
espace d’ouverture de l’UE au Sud ? Quelles relations économiques,
géopolitiques et culturelles découlent de la position d’interface ?
Introduction : De toutes les organisations
régionales au monde, l’Union Européenne est la plus intégrée de toutes. L’UE élargie à 27 pays en 2007, ce sont 485
millions d’habitants qui se répartissent sur environ 4 millions de km2 , c’est
un PIB cumulé supérieur à 10 000 milliards de dollars, soit environ 30 % du RNB
mondial. La réussite économique, largement facilitée par l’intégration fait de
l’Union Européenne un pôle important à l’échelle internationale. Toutefois, à
la différence de ses deux principaux concurrents et partenaires, l’UE connaît de profondes inégalités internes
et une construction communautaire en devenir ; elle peine aussi à défendre ses
intérêts dans les négociations internationales parlant rarement d’une seule
voix…
Cours 1
I) L’Union est un pôle et un acteur
majeur de la mondialisation :

L’industrie européenne représente 23% de la
production mondiale (2e après les Etats Unis). L’agriculture européenne
productiviste et intensive à forts rendements (rôle de la PAC mise en place en
1962) assure à l’UE son autosuffisance alimentaire et lui permet de développer
une industrie agro- alimentaire largement tournée vers l’exportation (2ème rang
mondial derrière les EUA). Les services représentent 71,6% du PIB
communautaire, L’UE assure 37.5% du commerce
mondial, les échanges intracommunautaires représentent 70% du commerce de
l’Union .Ses partenaires sont essentiellement les pays industrialisés. Les bourses
de l’Union jouent un rôle majeur dans les flux de capitaux (IDE). Londres est
la 1ere place d’affaire internationale. Influence politique (PESC et PED) et
culturel (4 langues parmi les dix plus parlées au monde, exportations de
produits de luxe, événements…). Un espace très attractif au cœur des
flux humains (économiques, politiques et touristiques).
II) Les facteurs de la puissance
européenne
Une
tradition commerciale et industrielle ancienne (Moyen Age, RI). Des efforts
poussés d’intégration économique et financière (Euro,…)
Un haut
niveau d’équipement et des infrastructures performantes.
3e
foyer de population (485 M
d’habitants) Une main d’oeuvre qualifiée, productive, à haut niveau de
vie. Des entreprises puissantes (FTN) s’adaptant rapidement à la
mondialisation. De nombreuses multinationales et des entreprises parmi les plus
dynamiques et les plus importantes du monde. D'importants mouvements de fusion
et de concentration (Arcelor-Mital). Une
présence dans le monde entier du fait des délocalisations d’unités de
production vers des pays à coûts salariaux faibles ou sur des marchés à
conquérir.
III) Les limites du poids et du
rayonnement de l’UE
Une influence politique, militaire et culturelle
limitée (cf guerre en Irak). Une population
vieillissante. Des retards en matière d’innovation. Une forte dépendance
énergétique. Une dynamique d’intégration encore insuffisante.
Cours 2
Introduction : Du Havre à Hambourg, sur plus d’un millier de
kilomètres de côtes, le littoral de la mer du Nord et de la Manche présente une
des plus formidables concentrations d’équipements portuaires au monde. Ici se
trouve l’un des lieux majeurs de la mondialisation…, l’interface principale
entre l’économie européenne, un des trois pôles de production de richesses dans
le monde, et ses partenaires, clients ou fournisseurs de matières premières et
de produits manufacturés. Mais aussi un espace éminemment concurrentiel,
théâtre d’une rivalité permanente entre les ports pour le contrôle du trafic
maritime.
I)
La Northern Range : Interface maritime majeure de
l’UE

La «
Northern Range » constitue la deuxième façade maritime du monde. Son rang et
l’importance de son trafic de produits manufacturés en conteneurs, leur
provenance et leur destination confirment la place de l’UE dans la
mondialisation : aire de puissance et deuxième marché à haut niveau de vie,
elle commerce avec l’ensemble du monde mais surtout avec les principaux
producteurs et consommateurs de biens manufacturés. La « Northern Range »
polarise la moitié du trafic portuaire de l’UE. Sa domination et sa
localisation s’expliquent par la vieille tradition commerçante des villes
littorales de l’Europe du Nord-Ouest et par l’organisation spatiale de l’UE :
son arrière-pays est le plus densément peuplé et riche. Mais les disparités
entre les hinterlands, plus ou moins bien desservis et actifs, établissent une
hiérarchie des différents ports: Rotterdam et Anvers au débouché de la dorsale
européenne dominent ; Hambourg desservant un arrière-pays élargi à l’Europe de
l’Est progresse ; Le Havre se limitant au Bassin parisien et à l’Ouest est plus
modeste. La qualité et la diversité des réseaux de transport qui les relient à
leur arrière-pays expliquent les synergies. Les vallées des grands fleuves
(Rhin, Meuse, Elbe, Seine) sont les axes privilégiés de ces arrière-pays.
II)
Des ports en concurrence
S’ils présentent une certaine complémentarité les
ports se livrent une rude concurrence pour attirer le trafic. Le Havre et
Anvers sont en concurrence pour desservir l’île de France par exemple.
L’hinterland constitué des Etats de l’Europe centrale et orientale est aussi
convoité par les ports de la façade méditerranéenne de l’UE. Ils ont multiplié
les aménagements pour recevoir les plus grands porte-conteneurs et améliorer
les dessertes terrestres et fluviales. Les ports sont dotés de puissantes ZIP
(zone industrialo-portuaire). Cela provoque des débats sur des thèmes
environnementaux auxquels les sociétés habitant ces régions de très fortes
densités sont sensibles.
Cours 3
Introduction :
La Méditerranée met en relation l’UE et les
PSEM, deux ensembles géographiques appartenant à plusieurs aires de
civilisation, présentant des niveaux de richesse et de développement très
inégaux et des régimes politiques différents. Les relations entre ces deux
ensembles sont anciennes et importantes. Les échanges culturels reposent aussi
actuellement sur les flux migratoires. Les relations économiques sont intenses
mais marquées par des dissymétries fondamentales. Une coopération
transméditerranéenne est en gestation grâce à des accords de partenariat
politique, financier et culturel. Le « printemps arabe » de 2011 peut accélérer
ce processus mais aussi le remettre en cause. Car la Méditerranée est aussi une
zone de clivage.
Une aire de partenariats :
La
Communauté européenne entretient, depuis l'origine, des relations étroites avec
les pays du bassin méditerranéen. La coopération entre la Communauté européenne
et la région méditerranéenne a en effet débuté dans les années 1960-70. Elle ne
cesse depuis de s'affirmer et représente aujourd'hui l'un des axes majeurs de
l'action extérieure européenne. Aujourd’hui les Etats de la Méditerranée
appartiennent à un « premier cercle » avec lesquels l’UE a signé des accords
dans le cadre de la politique européenne de voisinage en 2004. Cette initiative
avait été précédée par la signature en 1995 du « Processus de Barcelone »
devenu en 2008 l’Union pour la Méditerranée (UPM) qui souhaite créer une zone
de paix et de stabilité, développer la coopération économique et financière et
améliorer les niveaux d’éducation et l’intercompréhension culturelle. Une telle
politique de l’UE s’inscrit aussi dans une démarche d’extension de son
influence sur une aire géostratégique (canal de Suez, détroit de Gibraltar). De
plus suite aux élargissements de 1981 et 1986, la rive Nord est devenue une
frontière de l’espace Schengen. Les inégalités de développement justifient
selon les cas l’intensité ou la faiblesse des relations euro-méditerranéennes
qui demeurent dissymétriques. C’est pourquoi l’UE propose des aides aux Etats
partenaires de l’UPM (FEMIP/InfraMed).

Une aire de flux :
L’espace
méditerranéen est une interface, une région qui génère des flux importants. Des
flux migratoires (souvent
clandestins) du Sud vers le Nord (raisons économiques ou politiques).
L’espace méditerranéen constitue le premier bassin touristique du monde.
La plupart des flux touristiques sont du Nord vers le Nord (près de 170 million
de touristes par an) mais il existe aussi des flux touristiques nouveaux du
Nord vers les stations balnéaires des PSEM. Les échanges de marchandises dans
la région méditerranéene sont très dissymétriques. Les pays de l’UE exportent des produits dans
le monde entier au contraire des PSEM qui sont très dépendent des pays de l’UE
car une très grande portion de leur revenus dépendent de leurs échanges avec le
nord. Les flux de capitaux favorisent
aussi largement le Nord cependant il existe des flux financiers Nord-Sud. En
effet les FTN du Nord investissent dans les services, le tourisme, la chimie et
l’agroalimentaire dans les PSEM. Les PSEM sont donc des pays qui reçoivent
beaucoup d’IDE et de remises des pays de l’UE ce qui révèle que les PSEM sont
intégrés dans la division internationale du travail.