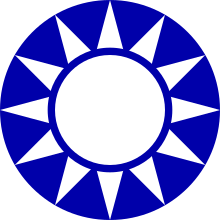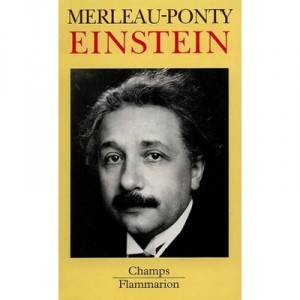UN MOMENT D’INNOVATION : LA DEUXIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE
Sur quelles bases repose la 2ème Révolution Industrielle ? Comment les innovations techniques transforment-elles les sociétés humaines ?
Introduction : La 1ère Révolution Industrielle (= Transformation rapide des modes de production grâce à des innovations techniques) qui commence à la fin du XVIII° siècle repose sur le charbon et la machine à vapeur.
I. Qu’est-ce que la 2nde Révolution Industrielle ?
- 2 sources d’énergie : Le pétrole et l’électricité qui est une énergie secondaire produite à partir du charbon, du pétrole ou de la force de l’eau (hydroélectricité) La maîtrise du courant électrique est du à Volta qui invente la pile électrique en 1800.
- Des inventions (Découverte de lois physiques ou de phénomènes chimiques permettant la création d’un nouveau produit [Aluminium] ou création d’un produit qui n’existait pas [Téléphone]) et des innovations (C’est l’utilisation pratique d’une invention ou d’une découverte. On distingue 5 types d’innovations : La fabrication de biens nouveaux, de nouvelles méthodes de production, l’ouverture d’un nouveau débouché, l’utilisation de nouvelles matières 1ères et la réalisation d’une nouvelle organisation du travail) dans différents secteurs :
■ Les applications de l’électricité sont nombreuses :
● Dans la transmission d’informations avec le télégraphe, le téléphone…
● Dans la production de chaleur, l’éclairage
● Dans l’électrolyse (Méthode qui permet de réaliser des réactions chimiques grâce au courant électrique) qui permet de fabriquer l’aluminium
■ Moteur à explosion qui révolutionne les transports : Automobile puis avion
■ Sidérurgie (Aciers) : Il devient plus résistant et est présent partout (Monuments, ponts, tour Eiffel
■ Chimie organique (Transformation des corps chimiques issus du vivant) : Matières plastiques et nylon, colorants, et début de la chimiothérapie
- La 2nde révolution industrielle concerne surtout les pays qui ont connu la croissance grâce à la 1ère RI et qui possèdent les moyens d’investir.
II. Comment passe-t-on de l’inventeur à l’industrie ?
- Au départ, les chercheurs, inventeurs de génie ou ingénieurs, sont isolés et n’avaient pas forcément connaissances des avancées scientifiques. Mais peu à peu des équipes de chercheurs se forment comme par exemple Edison fonde en 1874 le Menlo Park qui regroupe plusieurs laboratoires. D’autres laboratoires sont rattachés à des universités.
- Par la suite, les laboratoires sont intégrés aux grandes entreprises qui investissent beaucoup d’argent dans la recherche pour rester en pointe dans leur secteur. Elles possèdent un secteur recherche de développement chargé de faire de l’innovation en continue. (Ex : Renault en France)
- Enfin, les innovations sont protégées par des brevets (Droit exclusif de propriété d’un inventeur pour une durée limitée et sur un territoire donné), aux Etats-Unis et en France dès le XVIII° siècle. Le dépôt de brevets se multiplie avec la 2nde Révolution Industrielle. Ces brevets permettent aux chercheurs et aux entreprises d’être seuls, pendant un temps à pouvoir exploiter industriellement une invention. Ils peuvent aussi choisir de donner une licence à une autre entreprise, c'est-à-dire un droit d’exploitation industrielle contre une redevance. En 1883, la Convention de Paris instaure une protection internationale de la propriété intellectuelle (Dispositions juridiques qui reconnaissent un droit moral et financier à un inventeur sur son invention). Elle est signée rapidement par tous les pays industrialisés.
III. Comment cette Révolution industrielle modifie-t-elle les façons de produire et les modes de vie ?
A. Une nouvelle organisation du travail
- Taylor, ingénieur américain de la sidérurgie, met au point au début du XX° siècle une Organisation Scientifique du Travail (OST). Il mesure l’efficacité du travail ouvrier (Chronométrage, décomposition des gestes, observation de l’espace et des déplacements).
- Ses idées sont mises en application par Henry Ford, constructeur automobile lors de la production de la Ford T en 1908. Il met en place la 1ère chaîne de montage et s’assure ainsi des cadences de montages et réalise des gains de productivité.
Ensuite, il standardise sa production avec une seule couleur, des pièces allant sur plusieurs modèles. Tout ceci fait baisser les coûts de production.
Enfin, il augmente les salaires des ouvriers pour les fidéliser mais aussi pour leur permettre d’acheter la production.
Avec ces nouvelles méthodes, les usines deviennent plus grandes et moins nombreuses : On a une concentration.
On met au point des machines-outils qui font une partie des opérations.
On développe le commerce, la publicité pour écouler la production
Cependant, les ouvriers vivent mal ces transformations car le travail est déshumanisé. Le système ne sera pas appliqué de façon stricte car on se rend compte que le manque d’intérêt des tâches fait baisser la productivité. En France, le travail à la chaine reste minoritaire, il concerne surtout le secteur automobile.
B. Une modification des modes de vie des sociétés occidentales
La période 1850 / 1950 qui correspond à la 2nde Révolution Industrielle, s’accompagne d’une modernisation et d’une urbanisation accélérées des sociétés occidentales. Les modes de vie s’en trouvent bouleversés.
En effet, de plus en plus d’Occidentaux vivent dans un cadre de vie nouveau, la ville. C’est l’urbanisation. La ville connaît de nombreux changements : Apparition des égouts, des trottoirs mais aussi des constructions nouvelles comme les gratte-ciels dans les villes des Etats-Unis.
D’autre part, l’hygiène progresse grâce aux campagnes menées à l’école, au savon et aux vaccins. La nourriture se diversifie grâce aux progrès de l’agriculture et de la distribution. Une société de consommation se met timidement en place, les 1ers grands magasins apparaissent.
Enfin, les innovations techniques comme l’électricité se diffusent et les loisirs se développent ce qui montre un progrès du pouvoir d’achat des populations.
Conclusion : L’ensemble des inventions et des innovations qui caractérisent une Révolution Industrielle s’appelle un système technique : Il s’étudie sous 3 angles : l’invention et l’énergie dominante, leurs conséquences sur les techniques de production et d’organisation du travail et leurs répercussions sur les sociétés.